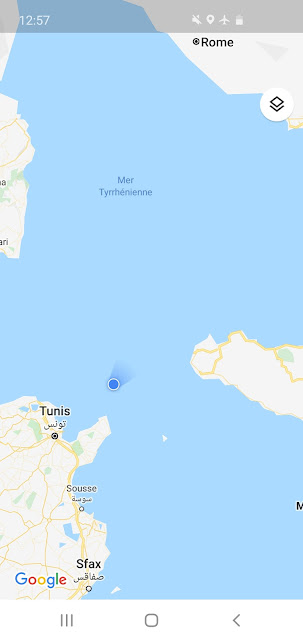Les arrivées de voyageurs internationaux ont chuté de 57 % au premier semestre
Depuis six mois, Marcel Diouf se répète brave ment la même phrase. «Ça va aller, Inch’Allah. L’hôtelier sénégalais refuse de céder au catastrophisme, quand bien même son auberge située à Mbodiène, sur la Petite Côte à 100 km au sud de Dakar, reste désespérément vide. Tous les matins, le personnel ouvre les onze chambres, nettoie la cour, entretient la piscine. « Puis on se connecte sur Internet mais il n’y a aucune réservation, pas même de nos clients traditionnels de France et du Canada. La saison haute est pourtant censée commencer en octobre », raconte M. Diouf, qui avoue peiner de plus en plus à verser le salaire de ses sept employés.
Les vols internationaux ont beau avoir repris mi-juillet au Sénégal, les touristes continuent de se tenir à distance, échaudés par l’évolution imprévisible de la pandémie de Covid19 à travers la planète. Le pays connaît les mêmes déboires que ses pairs africains. Du Maroc à l’Afrique du Sud, du CapVert à l’Ethiopie, le tourisme a connu un coup d’arrêt brutal et prolongé sur l’ensemble du continent. Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), la crise du secteur pourrait entraîner la destruction de 7 millions à 17 millions d’emplois sur l’année 2020, dans une région du monde déjà frappée par un chômage très élevé.
Au premier semestre, les arrivées de voyageurs internationaux en Afrique ont chuté de 57 %, selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Et la débâcle est loin d’être terminée : début septembre, la moitié des destinations africaines n’avaient tou jours pas rouvert leurs frontières. « L’industrie a été décimée », s’afflige Naledi Khabo, la directrice de l’Association du tourisme africain, une agence de promotion du continent basée aux EtatsUnis : « La banqueroute menace de nombreuses PME qui constituent l’essentiel des acteurs du secteur. Elles n’ont pas les fonds pour faire face et doivent souvent se débrouiller sans aides publiques. »
Un souvenir traumatisant
Le constat est d’autant plus amer que l’Afrique était, avant la pandémie, de plus en plus demandée par les touristes internationaux. Les arrivées étaient en forte hausse (+ 6 % en 2019). Le secteur représente aujourd’hui 10 % des recettes d’exportation du continent (contre à peine 5 % dans les années 1980), et plus d’un emploi sur cinq dans certains pays comme le Cap Vert ou l’île Maurice.
« La dynamique était excellente et tout s’est arrêté d’un coup », résume Sisa Ntshona, le patron de la Fédération du tourisme en Afrique du Sud : « C’est particulièrement regrettable pour une économie comme la nôtre, qui essaie de se diversifier dans les services pour moins dépendre des matières premières. » Le professionnel garde un souvenir traumatisant du premier coup de semonce : l’annulation, en janvier, d’un congrès international sur l’ophtalmologie censé se tenir en juin au Cap. L’événement, en préparation depuis cinq ans, devait accueillir 15 000 participants venus du monde entier. Soit 15 000 billets d’avion, 15 000 chambres d’hôtel et tous les à côtés.
L’Afrique du Sud, qui rouvrira ses frontières le 1er octobre après avoir été durement touchée par l’épidémie due au coronavirus, pleure ce tourisme de conférence dont elle était l’un des piliers continentaux. Elle s’interroge aussi sur l’avenir des safaris proposés aux amoureux de la faune sauvage dans les réserves du pays. « Rien ne permet de penser que les clients types – des Occidentaux fortunés et en général un peu âgés – vont se précipiter pour revenir tant que la situation sanitaire ne sera pas complètement sous contrôle », indique M. Ntshona.
Les animaux sauvages constituent la principale attraction du continent et drainent près de 80 % des voyages touristiques en Afrique, selon l’OMT. La désaffection des visiteurs a des effets en chaîne. Au Kenya, dans le sanctuaire de Mara Naboisho, à proximité de la réserve nationale du Masai Mara, la fermeture d’entreprises locales liées au tourisme a amputé les moyens de subsistance de plus de 600 familles masai. La protection de la faune risque d’en pâtir également, le tourisme fournissant souvent l’essentiel du budget des organismes publics de gestion des parcs nationaux, comme le Kenya Wildlife Service.
Des atouts pour rebondir
Le redémarrage du secteur s’annonce long et chaotique. Il pourrait nécessiter deux à quatre ans en fonction de l’évolution de la pandémie et de l’état des frontières, prédit Elcia Grandcourt, la directrice du département Afrique de l’OMT. En attendant, estimet elle, la crise devrait être l’opportunité d’impulser des changements. En s’interrogeant notamment sur l’ultradépendance de cette industrie vis à vis de certains clients, blancs, européens et nord américains. « Les pays africains réalisent que l’accent n’a pas été assez mis sur les touristes locaux et régionaux. Certains ont désormais un vrai pouvoir d’achat », insiste Mme Grandcourt. Les attirer nécessite de développer le transport intrarégional, encore embryonnaire, et d’ajuster les prix.
Aucun professionnel ne croit que cette clientèle puisse compenser l’absence des Occidentaux pour des prestations telles que les safaris, ces voyages de luxe qui peuvent coûter des centaines, voire des milliers d’euros la journée. « Mais l’idée n’est pas de remplacer les touristes traditionnels. Il s’agit plutôt de conquérir de nouveaux marchés encore trop peu exploités : la classe moyenne africaine, la diaspora afroaméricaine, les pays émergents d’Asie », énumère Naledi Khabo, de l’Association du tourisme africain. A l’en croire, l’Afrique a des atouts pour rebondir : « Dans le contexte de l’épidémie, certains voyageurs avides de repartir vont rechercher la nature et les grands espaces, ce que l’on trouve sans peine sur le continent. » Un avis que partage Jean François Rial, patron du groupe Voyageurs du monde, qui affirme vendre « chaque semaine » des voyages pour la Tanzanie.
L’Afrique peut aussi se targuer d’avoir globalement résisté mieux que d’autres parties du monde à la propagation du coronavirus. A l’exception de quelques pays, comme l’Afrique du Sud, la région a limité les dégâts sur le plan sanitaire : au 25 septembre, elle comptait officiellement 35 000 décès pour 1,2 milliard d’habitants. Selon M. Rial, « quand le tourisme mondial repartira enfin, c’est un argument que les Africains pourront mettre en avant ».